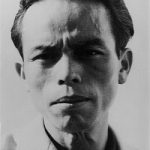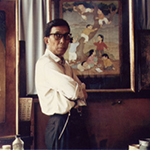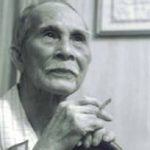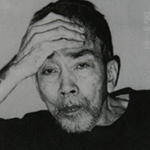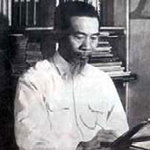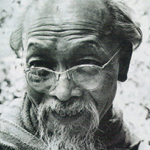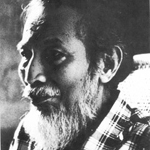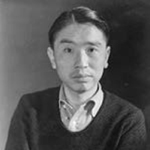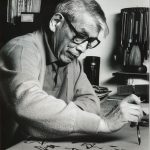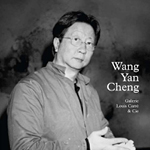L’École des beaux-arts de l’Indochine
Un vaste mouvement de quête de modernisme s’étend au XXe siècle de la Chine au Japon et le roman de l’École des beaux-arts de l’Indochine s’y inscrit à part entière.
À partir de 1887, en Asie du Sud-Est, une gestion administrative commune est instaurée avec la constitution de l’Union indochinoise française. Elle regroupe les protectorats de l’Annam, du Tonkin et du Cambodge, et la colonie de Cochinchine. Un gouverneur général dirige l’Indochine, à laquelle le Laos est rattaché en 1893.
En 1910, à Paris, le Prix d’Indochine est créé au sein de la Société coloniale des artistes français. Il prévoit d’offrir à l’artiste sélectionné une bourse qui lui permette de se rendre en Indochine, en plus de la gratuité des voyages.
Victor Tardieu est le titulaire du Prix d’Indochine en 1920. Diplômé de l’École des beaux-arts de Lyon, de l’Académie Julian et de l’École des beaux-arts de Paris, il est alors âgé d’une cinquantaine d’année. Il pose le pied sur le sol de l’actuel Vietnam en 1921. Peu après son arrivée, il reçoit la commande d’un immense panneau mural pour le décor du grand amphithéâtre de l’Université d’Indochine à Hanoï, entreprise monumentale qui l’occupera près de six années.

Dans l’amphithéâtre, œuvrant sur la grande fresque, Tardieu s’attache à un jeune peintre qui l’assiste, Nguyễn Văn Thọ, dit Nam Sơn, et l’accueille dans son atelier.
Le travail est long et donne au lauréat le temps de s’imprégner de la situation artistique locale. S’il remarque rapidement les qualités particulières de certains Vietnamiens qui participent à la décoration entreprise, il est frappé par le caractère artisanal de leur travail et s’étonne de constater l’absence totale de formation de qualité dans la région. En effet, seules quatre écoles « élémentaires » d’arts décoratifs existent alors : à Biên Hoa et à Thủ Dầu Một en Cochinchine, à Phnom Penh au Cambodge et à Hanoï au Tonkin, auxquelles s’ajoute l’école des professeurs de dessin de Gia Định en Cochinchine.
Victor Tardieu entreprend une longue analyse historique sur l’évolution de l’art annamite et rédige en 1924 un rapport qu’il adresse au gouverneur général de l’Indochine. Cette étude met en évidence la nécessité d’ouvrir une école des beaux-arts à Hanoï, comme pressenti et espéré depuis plus de trente ans par plusieurs historiens d’art.
Tardieu propose que soit sélectionnée sur concours une « élite d’élèves » dans le but de la former et de provoquer l’éclosion d’un réel renouveau artistique en Indochine. Ces élèves, après quelques années d’étude, pourront alors transmettre ses acquis, offrir aux futures générations annamites leurs services en tant que professeurs qualifiés, maîtres décorateurs talentueux, et seront à même d’inspirer les artisans…
« Éducation, culture du goût, faire comprendre aux Annamites l’intérêt qu’ils ont à ne pas abandonner leur art traditionnel, mais – puisqu’ils désirent lui apporter des éléments – diriger leurs efforts, les instruire dans les grandes lois générales, esthétiques, qui sont les mêmes sous toutes les latitudes, les engager à s’inspirer directement de la nature, simplement et sincèrement », voici en quelques mots la synthèse de son programme.

Ses arguments sont entendus, et l’École supérieure des beaux-arts de l’Indochine est instituée le 27 octobre 1924 par arrêté du gouverneur général Martial Merlin. L’enseignement qui est dispensé alors, sous la direction de Victor Tardieu (1924-1937), puis d’Évariste Jonchère (1938-1945), permet indubitablement la naissance de l’art moderne vietnamien. Le fonctionnement de l’École et la nature des enseignements reprennent ceux de l’École des beaux-arts de Paris tout en intégrant une formation poussée sur l’art traditionnel annamite.
Peu après sa nomination, afin de former son équipe et de préparer la rentrée de la première promotion, Victor Tardieu se rend à Paris. Il en profite pour diriger Nam Sơn vers une formation intensive aux Beaux-Arts et aux Arts décoratifs de Paris (ce qui permettra à ce dernier de rejoindre par la suite les rangs du corps enseignant à Hanoï). Il recrute le peintre Joseph Inguimberty.
L’équipe officielle des enseignants est constituée autour du directeur, Victor Tardieu, et du professeur en arts décoratifs, Joseph Inguimberty. Elle se compose des chargés de cours suivants : MM. Batteur (inspecteur du service archéologique à l’École française d’Extrême-Orient) pour le dessin architectural ; Stéphane Brecq (artiste peintre, ancien élève à Paris des académies de Jean-Paul Laurens et d’Edgard Maxence) ; Ferdinand Fénis de Lacombe (docteur ès sciences, détaché à l’Université indochinoise) ; et Jos Henri Ponchin (professeur de dessin au lycée) se répartissant les cours de dessin, de peinture et d’anatomie ; tandis que Victor Goloubew (membre de l’École française d’Extrême-Orient) assure les cours d’esthétique, d’archéologie et d’histoire de l’art.
Victor Tardieu s’implique pour le développement, en Indochine, d’un climat artistique et culturel. Il soutient l’organisation régulière de manifestations artistiques sur place à Hanoï, à Saïgon et à Paris. Soucieux de l’avenir professionnel et financier de ses élèves, il les guide dès les premières années et favorise avec énergie leur participation aux expositions et salons internationaux.

Bibliographie :
Fonds Victor Tardieu, INHA, espace Jacques-Doucet, archives 125/5-9
L’Avenir du Tonkin, années 1922-1940
Revue indochinoise illustrée, années 1910-1930
Bulletin de l’Agence économique de l’Indochine, années 1920-1940
Charlotte Aguttes-Reynier, L’Art moderne en Indochine, AAP – In Fine éditions d’art, Paris, 2023
Cliquer sur les photos pour plus d’information sur les artistes qui nous intéressent, peintres voyageurs venus d’Asie, ou aussi certains de leurs professeurs français.
Cette liste dépasse l’Ecole des beaux-arts de l’Indochine et elle cite plus largement certains peintres originaires de Chine, du Japon et d’Asie du Sud-Est et liés à l’Europe. Elle n’est pas limitée et n’a pas vocation à être exhaustive ni à les confondre dans un même courant ou une même école. Ces acteurs ont pour points communs le goût de l’art et le bénéfice d’une curiosité artistique vers une deuxième culture, orientale ou occidentale.
Vous détenez des documents d’archives ou éléments complémentaires sur les peintres d’Asie ou souhaitez un avis sur l’une de vos œuvres ? Contactez-nous